Pour lutter contre le réchauffement climatique, médias et journalistes sont priés de se décarboner. Une charte pourrait être introduite.
Par Alain Meyer
Crédibilité oblige, le monde journalistique doit rendre des comptes sur sa contribution pour freiner le réchauffement climatique. Dans les rédactions, des changements d’habitude s’imposent gentiment. Le recours à l’avion et à la voiture pour couvrir tel ou tel événement est questionné.
En France, une charte des bonnes pratiques vient d’être édictée par Reporterre, média indépendant publiant sur la toile des articles sur l’écologie. Une vingtaine d’organes de presse y promeuvent « un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique ». Treize commandements y sont listés, dont la pratique « d’un journalisme bas carbone ». Par exemple en réduisant l’empreinte par l’usage d’outils de travail moins polluants ou encore en incitant les rédactions à engager des journalistes locaux pour s’éviter des déplacements inutiles.
A l’impossible nul n’est tenu. Qu’en est-il en Suisse ? Des médias tentent le pari. Journaliste au quotidien Le Temps, Boris Busslinger a pourtant dû déchanter récemment, démontrant l’impossibilité de se rendre à la Conférence internationale sur le climat de Charm el-Cheikh, en Egypte, autrement qu’en avion. « Quelle que soit notre dose de bonne volonté, l’idéal se heurte à des considérations pratiques infranchissables », a-t-il résumé dans un article (Le Temps du 3 novembre 2022). Dès lors, il s’est demandé s’il était encore nécessaire de se rendre à ce genre de raouts ? « Y renoncer n’est pas défendable car les chances d’un échec du sommet auraient été renforcées sans pression médiatique », a-t-il argumenté. Les médias suisses font-ils assez aujourd’hui tandis qu’une association de journalistes climatiques vient d’éclore ?
« La question climatique recouvre toutes les rubriques », assure Florent Hiard, membre de cette association et journaliste au quotidien régional La Côte à Nyon (VD). Mais il ne se berce pas d’illusions. « Difficile de faire du journalisme assis derrière son bureau », confesse-t-il, ajoutant que la voiture reste indispensable pour son média car « les villages ne sont pas tous connectés aux transports publics ».
Idem dans l’Arc jurassien où la voiture reste incontournable. « Nous faisons en sorte d’utiliser des véhicules de catégorie d’efficacité énergétique A (moins de 95 g de CO2/km) ou B (de 101 à 120 g) », glisse Jérôme Steulet, co-directeur du groupe de médias BNJ (radios RTN, RJB et RFJ). Pour les cinq voitures électriques que compte son groupe, des bornes de recharge ont été installées près des studios. Problème : « Lorsque des journalistes sportifs doivent se rendre à des matches de hockey sur glace au Tessin, pas simple de leur dénicher alors une voiture avec une autonomie qui leur permettrait d’y aller et d’en revenir sans recharger une fois », dit-il.
Trains de nuit à développer. « La réduction de l’empreinte carbone relève surtout de contraintes budgétaires au sein des rédactions, plus que d’une volonté réelle », confient des membres de l’Association suisse des journalistes scientifiques (ASJS) interrogés par EDITO. Si les déplacements longue distance sont moins favorisés, emprunter l’avion reste le moyen le moins onéreux pour se rendre dans les capitales européennes. « L’offre en trains de nuit apporterait un changement des mentalités », avance l’ASJS.
Journaliste sciences et climat chez Heidi Media à Genève, Sarah Sermondadaz suggère d’autres pistes encore : site web épuré et moins lourd à charger, réflexions sur le télétravail ainsi que sur les budgets de déplacements avec une sélection plus stricte. « Il faut tout de même admettre que c’est l’intérêt éditorial qui prime », ajuste-t-elle. Quant à rédiger une charte pour rendre les rédactions plus conscientes de leur responsabilité, l’idée avance. Et si l’association des journalistes climatiques ne la rédige pas, leurs collègues scientifiques pourraient apparemment s’y coller.
1 commentaire
#1
Votre commentaire
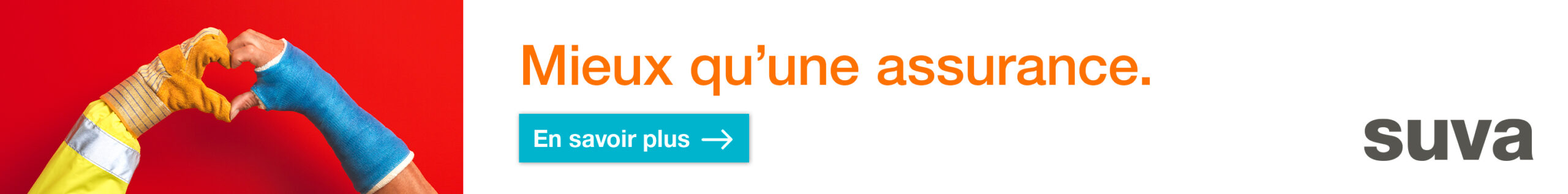
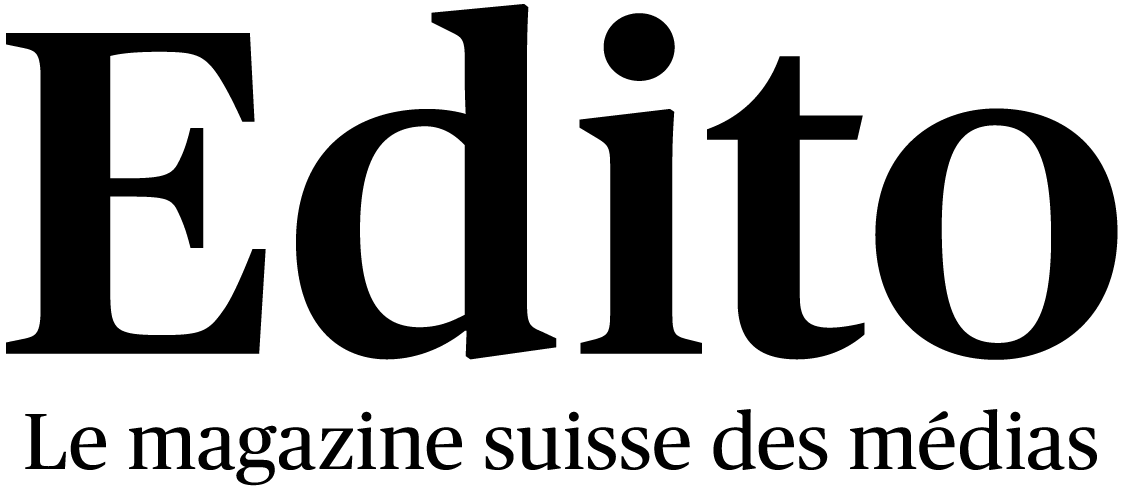



12.01.2023