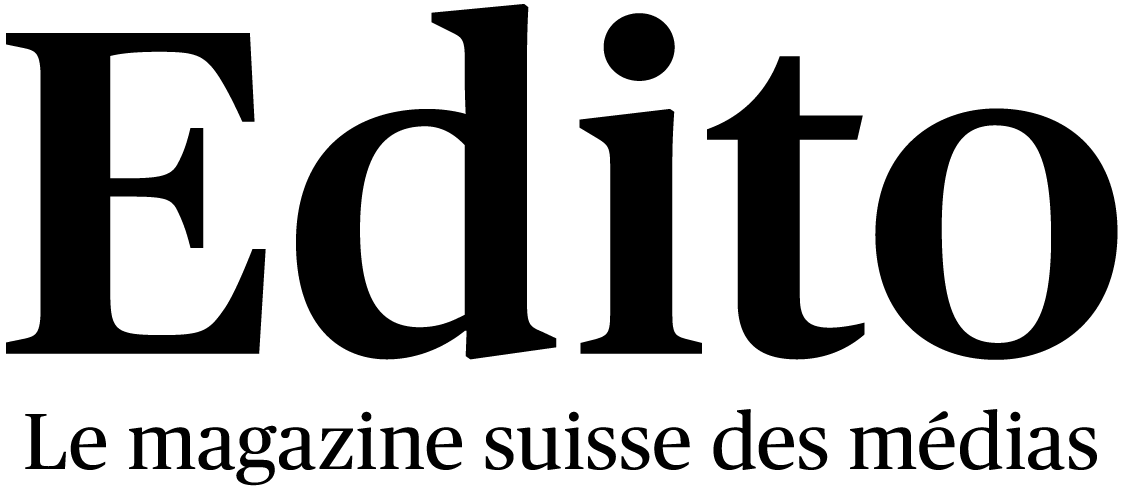Giuliana Sgrena (photo Michelangelo Chiaramida), la journaliste italienne et envoyée spéciale de «Il Manifesto», enlevée en Irak en 2005, était de passage à Genève à l’occasion de la présentation du film «Voix de reportages», consacré à sa consœur genevoise Laurence Deonna. Luisa Ballin l’a interviewée pour le site de la Presse Emblème Campagne (PEC) sur les conditions tragiques de sa libération et la protection des professionnels de l’information dans les zones dangereuses.
Luisa Ballin: Que pensez-vous de ce qui s’est passé au Mali avec la mort des deux journalistes français de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon?
Giuliana Sgrena: Je pense que le métier de journaliste est devenu très dangereux. Je me demande souvent quelles pourraient être les mesures pour éviter que cette profession soit aussi périlleuse, car je suis convaincue que nous ne pouvons pas renoncer à faire notre métier qui est d’informer y compris dans les zones difficiles. De nos jours ce qui prévaut dans les zones de conflit ce sont les reporters «Embedded», embarqués avec les militaires et je pense que ce n’est pas la vraie façon de faire du journalisme. Il faut aller chercher les informations, les vérifier et les écrire ou les transmettre. Pour continuer de le faire, il faudrait un minimum de protection.
De quelle manière pourrait-on protéger les professionnels de l’information au Mali, en Irak, pays où vous êtes rendue à plusieurs reprises et où vous avez été enlevée, et en Syrie, où il est pratiquement impossible de travailler comme journaliste?
Il devrait y avoir un réseau international indépendant, au service des représentants des médias. Grâce aux nouvelles technologies de l’information, nous avons de nombreuses possibilités de suivre tous les mouvements. Nous sommes d’ailleurs sans cesse espionnés ! Tout le monde sait où nous allons et ce que nous faisons. Pourquoi ne pas utiliser ces technologies de façon positive pour vérifier si tout va bien pour un journaliste qui se trouve dans une zone difficile ? Nous pourrions être épaulés par des personnes fiables qui s’engageraient à suivent notre parcours et qui seraient capables d’intervenir en cas de difficulté. Certes, une telle structure n’est pas facile à mettre en place, mais nous devrions pouvoir y parvenir.
Pensez-vous à une structure composée uniquement de journalistes ou également de représentants d’organisations non gouvernementales?
Nous pourrions associer des ONG à cette structure parce nous nous sommes souvent trouvés dans des situations similaires. Mais il faudrait que ces organisations non gouvernementales soient indépendantes, car dans le cas contraire, d’autres intérêts pourraient prévaloir.
Après la publication de votre livre intitulé «Fuoco amico» («Feu ami», paru chez Bianca Feltrinelli)et avec le recul, comment analysez-vous ce qui vous est arrivé lorsque vous avez été enlevée en 2005, pendant un mois en Irak?
J’avais tenté de prendre toutes les précautions pour éviter d’être enlevée, mais à l’évidence cela n’a pas suffi. Je ne pense pas que mes ravisseurs m’aient choisie comme cible de l’enlèvement, je me suis trouvée à un endroit où je ne devais pas être à ce moment-là. D’autres personnes ont été enlevées à endroit, mais je ne le savais pas. En tant que journalistes, nous prenons des risques lorsque nous sommes dans certaines situations et malheureusement le tribut à payer est très lourd. Mais nous ne pouvons pas renoncer à exercer notre métier.
De plus en plus de professionnels de l’information sont enlevés dans plusieurs pays. Est-ce devenu un business?
C’est devenu une arme de guerre. Mes ravisseurs m’ont dit: nous utilisons toutes les armes dont nous disposons y compris toi! De fait, je me suis sentie utilisée comme une arme. Sans oublier l’aspect business. Les ravisseurs ne sont pas partout pareils, ils peuvent avoir des objectifs différents.
Contre qui vos ravisseurs vous ont-ils utilisée?
Ils voulaient m’utiliser pour obtenir des résultats précis. Mes ravisseurs faisaient partie d’un groupe qui luttait contre l’occupation de leur pays. Ils exigeaient le retrait des troupes d’occupation y compris italiennes. Je ne pense pas qu’ils s’imaginaient qu’un enlèvement suffirait à obtenir un retrait. Ils demandaient un résultat politique qui était la réinsertion des Sunnites dans le panorama politique irakien, parce que mon enlèvement est intervenu après les élections de la fin janvier 2005. Seuls quelques Sunnites avaient participé à ces élections puisque la grande majorité d’entre eux les avaient boycottées affirmant qu’il ne fallait pas voter sous occupation. Les Kurdes et les Chiites ayant voté, les Sunnites se sont trouvés en difficulté. Ils étaient hors du jeu politique et des affaires, pouvoir et business allant souvent de pair. Ils cherchaient ainsi à se réinsérer. Mes ravisseurs ont donc aussi demandé de l’argent.
Le paiement d’une rançon est tabou. Que pouvez-vous en dire?
Lorsqu’il s’agit d’enlèvements qui ont lieu dans des pays en guerre, où plus aucune légalité ne prévaut, on ne peut pas avoir la même attitude que lorsqu’il s’agit de pays où la légalité existe. Dans une guerre, tous sont hors la loi : ceux qui font la guerre, ceux qui occupent un pays et ceux qui enlèvent des personnes. Dans les cas où des professionnels se trouvent dans ces pays pour faire leur travail, dans des situations qui ne sont pas normales, et qu’ensuite il y a une demande de rançon pour les libérer, il faut payer pour sauver des vies humaines.
Dans votre cas, outre votre enlèvement, il y a eu la mort de celui qui vous a libérée. Où en est l’enquête sur la mort de Nicola Calipari?
Malheureusement, l’enquête n’avance pas. Nous nous sommes battus pour qu’il y ait un procès en Italie à l’encontre de Mario Lozano, le soldat de l’armée américaine qui a tiré contre notre voiture. Nous n’y sommes pas parvenus malgré un procès préliminaire lors duquel le juge avait décidé d’envoyer Mario Lozano devant la justice pour l’homicide politique volontaire de Nicola Calipari, le numéro deux du SISMI (les services italiens de la sûreté de l’Etat, ndlr) et pour la tentative d’homicide contre moi et contre l’autre agent du SISMI Andrea Carpani.Nous sommes allés en Cour d’assises. Lors du procès préliminaire, Lozano était introuvable. Il n’avait pas d’avocat de confiance mais disposait d’un avocat commis d’office. Puis le procès en Cour d’assises a commencé, Lozano a nommé un avocat et ne s’est jamais présenté. Son avocat a demandé de revoir les questions dont nous avions discuté lors du procès préliminaire, comme la possibilité de juger Lozano. La veuve de Nicola Calipari et moi avons accepté de discuter. Malheureusement, la Cour d’assises est arrivée à la conclusion opposée à celle que le juge avait prononcée lors du procès préliminaire. A la Cour d’assises, il y avait un jury populaire. Le juge a conclu que nous n’avions pas le droit de juger Mario Lozano en se basant sur « la coutume du drapeau ».
De quoi s’agit-il?
D’une pratique obsolète utilisée il y a très longtemps lors de conflits en mer, qui décrétait qu’un soldat répondait uniquement au drapeau du pays qu’il portait dans son sac à dos. Dans le cas de Lozano, celui des Etats-Unis. Après cette sentence, le Ministère public, l’avocat de l’Etat italien – qui s’était constitué partie civile – et moi, avons fait recours à la Cour de cassation. Le Procureur général a jugé la sentence de la Cour d’assises sans fondement, la « coutume du drapeau » étant obsolète. Mais notre recours a été rejeté car le juge a conclu qu’il ne s’agissait pas de crimes de guerre parce qu’il n’y avait eu qu’un mort ! Après avoir été blessée tout comme le deuxième agent du SISMI par les tirs de Lozano lorsque nous étions à 900 mètres de l’aéroport pour rentrer à Rome, j’ai été condamnée à payer les frais de justice. S’il s’était agi d’un crime de guerre nous aurions pu avoir ce procès. Le résultat ? Pour l’Italie, il n’y a plus aucune possibilité que Mario Lozano soit jugé. Et nous ne pouvons pas faire recours auprès d’une cour internationale puisque ni l’Irak, ni les Etats-Unis ne reconnaissent la Cour pénale internationale.
Après avoir beaucoup œuvré pour vous libérer, le gouvernement italien vous a-t-il soutenue?
Il y a eu plusieurs changements de gouvernement en Italie. Lorsque j’ai été libérée, Silvio Berlusconi était Premier Ministre, lorsque le procès en Cour d’assises a débuté, le Premier Ministre était Romano Prodi – dont le gouvernement s’était constitué partie civile – et lorsque nous sommes allés en cassation, Silvio Berlusconi était revenu au pouvoir. Pendant l’intervention de l’avocat de l’Etat italien, un appel téléphonique est arrivé de Palazzo Chigi (siège de la Présidence du Conseil des ministres italien, ndlr) disant qu’il fallait tout arrêter. Le Gouvernement italien a ainsi décidé qu’il valait mieux ne pas avoir de procès. Avec tous les gouvernements qui se sont succédé en Italie, il n’y a jamais eu de pressions particulières sur les Etats-Unis pour que ce procès ait lieu. Les Etats-Unis avaient fait une enquête militaire qui avait conclu que ce genre de chose arrive en guerre et qu’il n’y avait pas de motif pour juger Lozano. Et aujourd’hui en Italie, on ne parle plus de Nicola Calipari.
Que peuvent faire les journalistes?
Ils peuvent sensibiliser l’opinion pour défendre leurs consœurs et leurs confrères et toutes les personnes qui se trouvent dans une zone difficile pour faire leur travail. Je rappelle que Nicola Calipari avait déjà libéré les deux Simone (Simona Torretta et Simona Pari, ndlr). Nicola était un homme au service de l’Etat. Il n’était pas au service du gouvernement mais au service des citoyens italiens. J’estime qu’il faut protéger ceux qui défendent les personnes qui font leur travail, journalistes et volontaires.
Lors du retour de la dépouille de Nicola Calipari en Italie, le pays entier lui avait pourtant rendu hommage. N’est-il pas considéré un héros national?
Avant de libérer des personnes enlevées, Nicola Calipari avait lutté contre la ndrangheta (la mafia calabraise, ndlr), lorsqu’il travaillait à l’Office des migrations. C’était un homme bien que tout le monde a célébré comme un héros et que beaucoup préfèrent oublier.
Pourquoi?
Je pense que le meurtre de Nicola Calipari n’était pas seulement dû aux Américains, mais qu’il y avait aussi une complicité italienne. Lorsque Calipari a été tué, il y avait un affrontement au sein des services italiens, structure composée d’une aile très pro-américaine estimant qu’il ne fallait pas traiter pour libérer les personnes séquestrées et qu’en tant qu’alliés des Américains, l’Italie devait suivre la même ligne qu’eux. L’autre aile, non pas anti-américaine, mais un peu plus indépendante pour une question de souveraineté nationale, estimait qu’il fallait tout faire pour ramener ses concitoyens à la maison. Après la mort de Calipari, cette aile a été laminée et la composante très pro-américaine a prévalu. Lorsque Nicolas Calipari se trouvait à Bagdad pour venir me chercher, il a reçu un appel. Des gens voulaient l’envoyer ailleurs. S’il était allé là où la personne qui était au bout du fil voulait qu’il aille, il aurait certainement fini dans une embuscade. Il ne m’aurait jamais libérée et il serait mort de toute façon…Je lui dois deux fois la vie. Non seulement il m’a libérée, mais il m’a aussi protégée avec son corps lorsqu’ils nous ont tiré dessus.
Etes-vous retournée en Irak?
Oui, j’y suis retournée deux fois, à la recherche des lieux de cette tragédie et pour retrouver un sentiment de sécurité que je n’avais plus.
Quelle est la première chose que vous avez faite après votre enlèvement?
Après mon enlèvement en 2005, je suis allée en Afghanistan pour suivre les élections. Si je n’avais pas recommencé tout de suite à travailler dans des zones difficiles, je ne l’aurais sans doute plus jamais fait.
Propos recueillis par Luisa Ballin
Votre commentaire