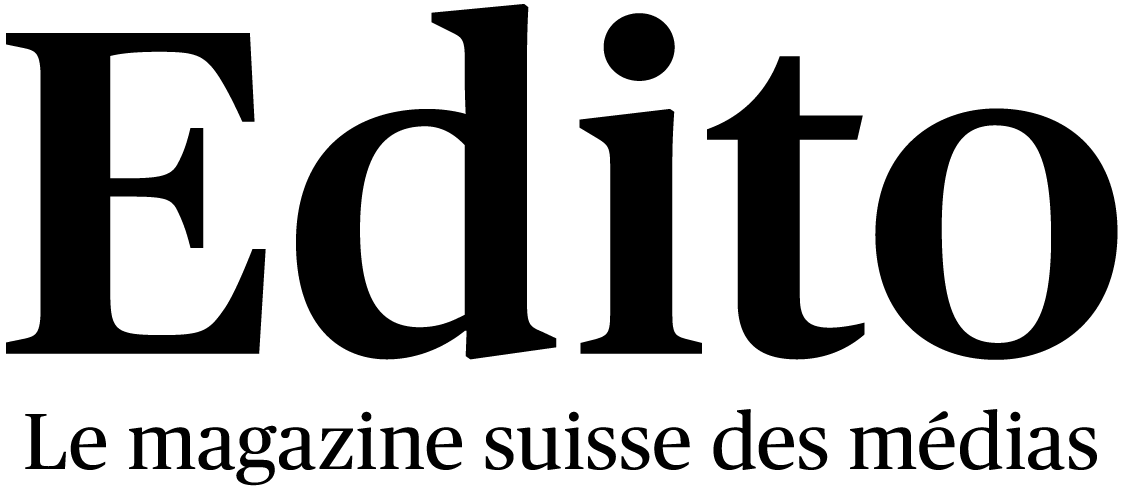La journaliste de la Tribune de Genève Sophie Roselli est la lauréate du Prix Jean Dumur 2018, distinction la plus prestigieuse du journalisme en Suisse romande. Interview d’une journaliste reconnue qui va quitter la profession à la fin de l’année.
EDITO: Que représente pour vous l’obtention du Prix Jean Dumur?
SOPHIE ROSELLI: Le Prix Jean Dumur représente l’un des plus beaux prix suisses du journalisme, parce qu’il est décerné depuis trente et un an par des journalistes émérites. Cette distinction me touche particulièrement, car le jury a choisi de me récompenser sachant que je vais quitter la profession.
Vous quittez la profession alors que vous êtes une journaliste d’investigation reconnue. Comment motiver de jeunes journalistes à se lancer dans cette difficile mais nécessaire mission?
C’est une question de passion, de motivation et d’engagement. Si vous avez la curiosité, la ténacité, le goût de l’enquête et le tact, les portes s’ouvriront. Malgré toutes les difficultés de la profession, il y aura toujours de la place pour des journalistes qui ont la flamme.
Ce prix est-il aussi celui de l’investigation?
Le Prix Dumur a le mérite de mettre en lumière l’investigation et les difficultés de cet exercice, même en Suisse romande. Parlons des pressions par exemple, même si elles n’ont rien à voir avec celles que peuvent subir des journalistes dans d’autres pays. Mais elles sont quand même bien présentes. Elles peuvent venir de chargés de communication, d’interlocuteurs qui menacent de déposer plainte ou qui tentent d’empêcher la publication d’un article. Il y a aussi les tentatives d’intimidation ou de décrédibilisation directes ou indirectes.
«N’oublions pas que les grandes enquêtes commencent au coin de la rue.»
Dans ce contexte, peut-on encore décemment faire de l’investigation en Suisse romande?
A mon sens, l’investigation est un sacerdoce, parce qu’elle nécessite un engagement personnel particulier. Mais cela ne suffit pas. Elle doit être encouragée et soutenue pour essaimer dans toutes les rédactions. Et en particulier dans les rubriques locales. N’oublions pas que les grandes enquêtes commencent au coin de la rue. Il faut favoriser cette culture de l’investigation au sein des rédactions et cela nécessite des compétences et des moyens.
Pourquoi quitter la Tribune de Genève et le journalisme?
C’est la question que tout le monde me pose… Cela peut paraître surprenant de quitter la « Tribune de Genève », où j’ai bénéficié pendant huit ans d’une grande liberté dans le choix de mes enquêtes, où Pierre Ruetschi, rédacteur en chef jusqu’à fin août, m’a accordé du temps et m’a confié la responsabilité d’un nouveau pôle enquête. Malheureusement, les conditions de travail se sont détériorées d’années en années, en raison des choix économiques et organisationnels du groupe zurichois Tamedia, propriétaire du quotidien genevois. J’en ai tiré les conséquences. Ces changements structurels m’ont finalement décidée à repenser mon avenir professionnel.

Lausanne, 13 novembre 2018, Sophie Roselli, lauréate du Prix Jean Dumur 2018. ©Florian Cella/24Heures
En quoi votre travail de journaliste d’investigation a-t-il évolué ces dernières années ?
Tout journaliste est amené à enquêter sur des sujets plus ou moins sensibles. Et son travail devient de plus en plus exigeant, parce qu’il est aussi davantage exposé à travers les réseaux sociaux. Le journaliste polarise: il est perçu comme un héros ou un zéro. J’observe aussi que les chargés de communication prennent une place de plus en plus importante, en tout cas à Genève. Souvent, ils verrouillent les portes plus qu’ils ne les ouvrent et semblent oublier qu’ils ne travaillent pas pour une personne mais pour le bien public. Conséquences: le journaliste doit davantage aller à la pêche aux informations en amont. D’où l’importance de développer un bon réseau d’informateurs. Mais tout cela prend du temps et nécessite des forces de travail.
«Moins de journaux, c’est moins de journalistes et cela conduit inévitablement à un appauvrissement du débat démocratique.»
Quel souvenir garderez-vous de ces années de journalisme ?
Ces trois dernières années ont été particulièrement intenses. J’ai beaucoup travaillé sur les questions de djihadisme. J’ai traité du volet suisse de l’affaire Ramadan, qui a bouleversé la société genevoise. Et puis, il y a eu l’affaire Maudet. Autant de sujets traités à l’ancienne, sans grande technologie, mais basés essentiellement sur des informateurs. Tout cela ne serait jamais sorti au grand jour sans la volonté de personnes décidées à dénoncer des dysfonctionnements dans l’espoir de voir les choses changer. Je pense à ces femmes et à ces hommes, souvent restés dans l’ombre, qui ont mené des démarches avec beaucoup d’énergie en prenant des risques et m’ont fait confiance.
Comment voyez-vous l’avenir de la presse romande?
Ma crainte, c’est de voir la concentration des médias se développer. En écoutant la revue de presse de la radio RTS chaque matin, tout le monde peut s’en rendre compte. Il y a encore cinq ans, on présentait un sujet par titre. Dorénavant, il est courant de citer un sujet pour trois ou quatre titres. Moins de journaux, c’est moins de journalistes et cela conduit inévitablement à un appauvrissement du débat démocratique. On ne s’en rend pas forcément compte, parce que, paradoxalement, nous sommes noyés sous les nouvelles. Mais lesquelles? Je suis frappée de voir que cela ne suscite pas de grandes mobilisations citoyennes et politiques. Il faudra peut-être un jour déclarer l’information comme un bien culturel à protéger.
Eloge de Sophie Roselli, lauréate du Prix Dumur 2018. Les quatre qualité clés d’une journaliste hors norme. Ma laudatio prononcée lors de la remise du prix ce jour. Merci et Bravo @Borroloola #journalisme #Geneve #medias @tdgch https://t.co/5Jf5FVImJN
— Pierre Ruetschi (@pierreruetschi) 13 novembre 2018

Sylvain Bolt
Journaliste Web pour Edito.ch/fr. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel.
Votre commentaire