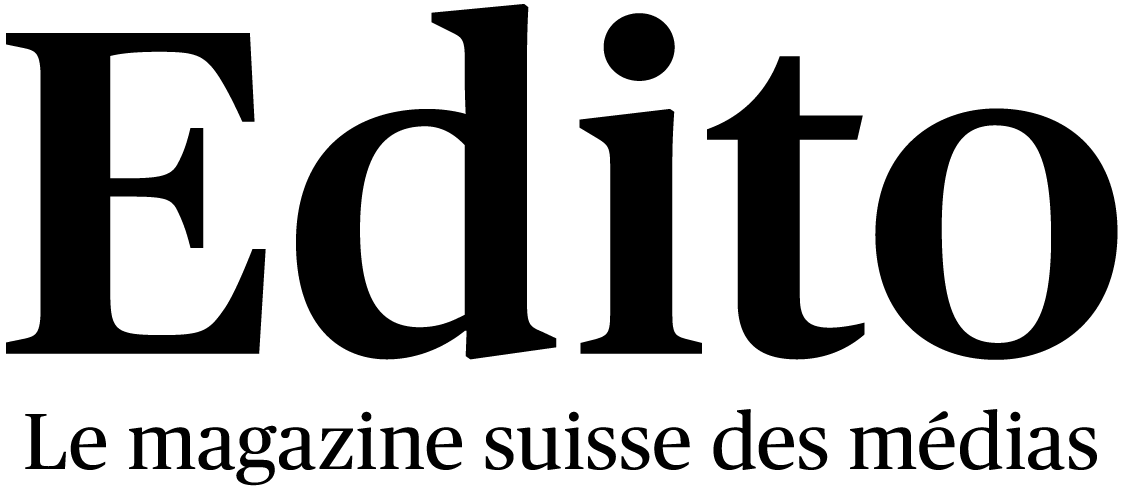Journaliste indépendant vivant à Brooklin, Kessava Packiry travaille
pour plusieurs journaux romands. Il livre ici son ressenti sur les violences raciales aux Etats-Unis.
Par Kessava Packiry, New York
Karen : J’ai découvert le mot ce printemps. Et j’aurais peut-être préféré ne jamais l’ajouter à mon vocabulaire. Karen, aux Etats-Unis, désigne une femme blanche xénophobe, qui ignore au fond d’elle-même qu’elle l’est, mais qui est sûre de ses bons droits. C’est en visionnant une vidéo postée sur les réseaux sociaux, largement reprise et commentée par les médias du pays, que j’ai réalisé à quel point il pouvait être banal, ici, pour une personne de couleur de se retrouver dans une situation délicate, en se voyant injustement accusée d’un délit grave.
Dans cette histoire, un féru d’ornithologie, peu desservi par son solide gabarit, a demandé à une jeune femme de bien vouloir tenir son chien en laisse, comme les règles de Central Park le stipulent à certaines heures de la journée. Sa demande s’arrête là. Mais la New-Yorkaise, se sentant agressée, exhorte l’homme de s’éloigner tout en retenant de manière hystérique son petit animal par le collier, manquant de l’étouffer. Et ça dégénère, quand elle met à exécution sa menace d’appeler les policiers, pour leur signaler qu’« un homme noir » est en train de l’agresser, qu’elle a vraiment peur et qu’il faut venir très très vite.
George Floyd n’est pas le seul en 2020 à être décédé en raison de sa couleur de peau.
Plates excuses. Cette vidéo m’a laissé perplexe. Comment l’homme aurait-il pu se défendre s’il n’avait pas filmé la scène ? Combien d’autres hommes ou femmes comme lui sont victimes de Karen, et quelle galère doivent-ils endurer pour prouver leur innocence ? L’histoire de cette Karen s’est mal terminée pour elle : elle a recueilli un flot d’insultes incendiaires sur les réseaux, a perdu son emploi au sein d’une société financière, s’est fait retirer son chien pour maltraitance. Aux médias qui ont retrouvé son nom et lui ont demandé une réaction, elle a déclaré qu’elle n’était pas du tout raciste, qu’elle travaillait sans problème avec des collègues noirs, qu’elle ne s’était pas rendu compte du mal qu’elle faisait. Elle s’est excusée platement.
Je suis moi-même une personne de couleur, mais je n’ai jamais été confronté, ici, à ce type de racisme ordinaire. Du moins pas consciemment. Cela fait plus de deux ans que je vis à New York, à Brooklyn, dans un quartier mixte, agréable. Mon coiffeur est un grand Black, mon épicier préféré un Latino, l’occupant du penthouse de notre immeuble un Blanc, heureux jeune retraité de l’immobilier, qui ne manque jamais d’échanger quelques mots de français avec moi.
Donc non, je n’ai jamais ressenti d’animosité à mon égard, pas plus à New York qu’ailleurs dans ce pays que ma compagne et moi avons déjà bien parcouru. Mais l’affaire George Floyd, du nom de l’Afro-américain mort étouffé sous le genou d’un policier le 25 mai, a été révélatrice pour moi. Elle a provoqué une onde de choc inouïe, ravivé des plaies qui remontent jusqu’à l’esclavage et rappelé à quel point ces drames, trop souvent tus, se déroulent souvent dans le silence. Cette fois, il s’est vraiment passé quelque chose. Mais est-ce que la société américaine va pour autant se transformer ? Va-t-on enfin assister à des réformes sérieuses, pour mettre fin aux brutalités policières ? Je demande à voir.
D’autres exemples. Avec l’affaire Floyd, Black Lives Matter s’est donné un nouvel élan. Né aux Etats-Unis en été 2013 après l’acquittement du Blanc qui a tué le jeune Afro-américain Trayvon Martin, le mouvement organise encore régulièrement des marches de protestations. Je suis allé voir les différents endroits de New York, où les lettres composant le slogan ont été peintes en immenses lettres jaunes sur le bitume, y compris devant la Trump Tower. La première réaction est une certaine émotion. Mais doit-on vraiment se réjouir qu’en 2020 encore il faille écrire en grand que la vie des Noirs compte ?
Le racisme institutionnalisé est tenace aux Etats-Unis, sournois. La mort du jeune Emmett Till, en 1955, dans le Mississippi, torturé à mort par des Blancs, a été à l’origine de l’essor du mouvement afro-américain des droits civiques. Bien sûr, beaucoup a été accompli depuis. Mais pas assez.
George Floyd n’est pas le seul en 2020 à être décédé en raison de sa couleur de peau. Il y a par exemple eu, en Géorgie, un Etat au lourd passé ségrégationniste, Ahmaud Arbery, un joggeur noir lynché par des Blancs qui prétendent l’avoir pris pour un cambrioleur. Ni George Floyd, ni Ahmaud Arbery ne portaient d’arme. Ils n’étaient pas menaçants. George Floyd a répété plusieurs fois qu’il n’arrivait pas à respirer et Ahmaud Arbery a cherché à éviter ses agresseurs qui le poursuivaient dans leur pick-up.
Ces drames surviennent alors que les Afro-américains se retrouvent déjà moins favorisés que les Blancs au regard de nombreux indicateurs socio-économiques. Le Covid a exacerbé ces disparités raciales : il tue davantage les Noirs. Un autre chiffre inquiétant, celui de la mortalité des femmes noires lors de l’accouchement : à New York, une Noire risque 12 fois plus de mourir en couche ou de complications liées à la grossesse qu’une Blanche.
Le Covid a exacerbé les disparités raciales : il tue davantage les Noirs.
Radicalisation ? Black Lives Matter continue d’organiser des manifestations, en profitant de la médiatisation de l’affaire Floyd. L’autre jour, j’observais encore une trentaine de manifestants à vélo, scandant des slogans contre la police. Et dans mon quartier, les signes de solidarité sont nombreux. Des commerçants affichent toutefois des pancartes « Black-owned business » sur la devanture de leurs portes. Non plus pour se prévenir de casses, comme lors des émeutes aux heures les plus chaudes de cet été, mais par fierté. Certains y voient des signes de radicalisation.
Dans ce pays où le président Donald Trump divise plutôt que rassemble, et montre généralement peu d’empressement à condamner des dérapages racistes, les revendications des Noirs ont posé leurs empreintes dans la campagne présidentielle. J’ai été frappé par les remarques, en Suisse comme en France, de personnes choquées que l’on puisse titrer sur la couleur de peau de Kamala Harris, choisie par le démocrate Joe Biden pour être sa colistière et devenir, en cas d’élection, la première vice-présidente de l’Histoire des Etats-Unis.
« Aurait-on précisé la couleur de sa peau si elle avait été blanche ? », a réagi un inter-naute à un titre du matin.ch. Mêmes remarques à propos d’un article du Monde, notamment de la part du philosophe et essayiste Raphaël Enthoven. Pour ma part, je défends les journaux qui ont fait ce choix. Vu des Etats-Unis, c’est une information de base. Si Kamala Harris n’a bien sûr pas uniquement été choisie pour sa couleur de peau, elle l’a bien été en partie pour cette raison-là.
Inquiétant. Joe Biden avait indiqué dès mars qu’il nommerait une femme, et depuis l’affaire Floyd les pressions pour qu’il choisisse une Afro-américaine se sont faites plus fortes. Quelques jours avant son choix, une lettre ouverte signée par une centaine de personnalités noires ont insisté pour qu’il désigne une Afro-américaine, sans quoi il perdrait l’élection. Aujourd’hui, c’était attendu, Kamala Harris est attaquée sur ses origines. Certains lui reprochent de ne pas être éligible comme vice-présidente, parce ce que ses parents n’étaient pas naturalisés quand elle est née aux Etats-Unis. Un faux débat. Et comme elle a un père jamaïcain et une mère indienne, on lui reproche aussi de ne pas vraiment représenter les Afro-américains.
Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j’ai lu le livre de Jean-Paul Dubois, ses chroniques alors qu’il était correspondant durant les années 1990‒2000. Son titre est plus que jamais d’actualité : « L’Amérique m’inquiète », sérieusement.
Votre commentaire